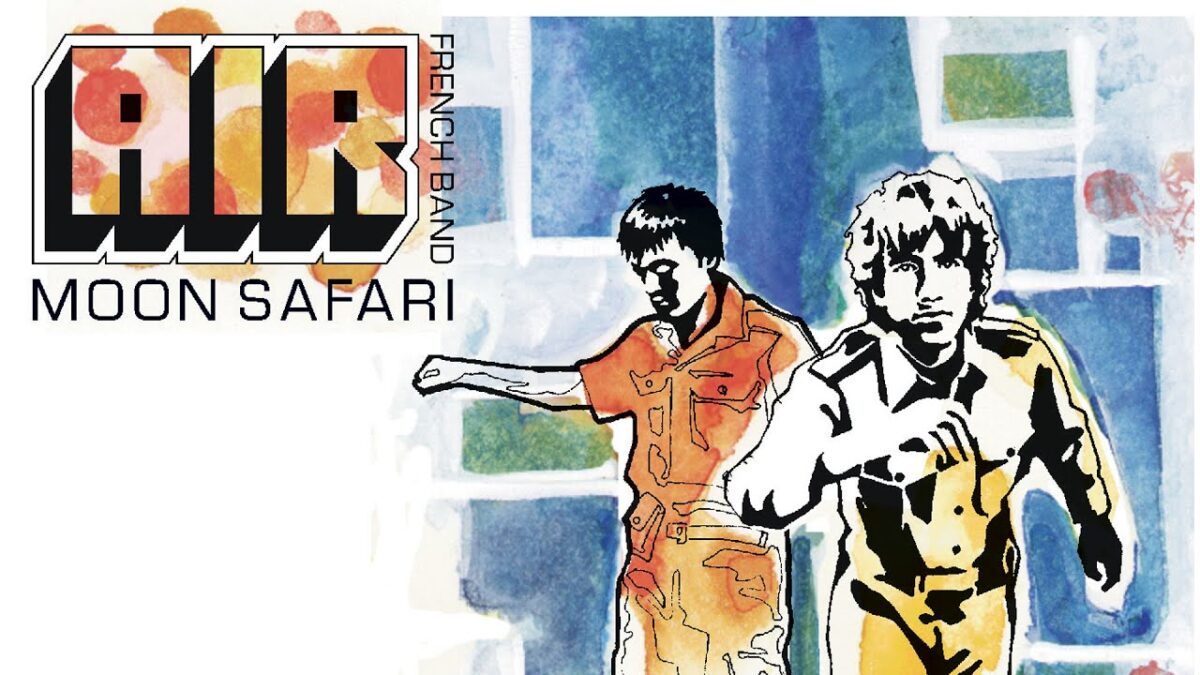Un morceau qui se conduit tout seul
Comme un moteur ressuscité dans un garage à minuit, un grondement de synthé surgit de l’asphalte, lent et régulier. Nightcall débute avec cette voix robotique, froide et captivante, enveloppée dans une brume de textures analogiques. Ce qui commence là, ce n’est pas de la musique, c’est une transmission. Des codes néon portent un message secret. Kavinsky hante plus qu’il ne chante. La chanson palpite comme un cœur perdu résonnant dans un rêve rétro-futuriste. Elle a percuté la bande-son de Drive en 2011 comme un crissement de pneu au ralenti, et soudain, chaque autoradio du monde semblait scintiller de menace et de désir.
Comme un mythe issu d’une borne d’arcade, Vincent Belorgey, l’homme au volant, a inventé le personnage de Kavinsky. Revenu d’entre les morts pour faire de la musique, un jeune homme tué dans un accident de voiture en 1986. Ce récit a tout d’un film de série B, et c’est bien ainsi qu’il l’a assumé. Jusqu’au rouge sang Ferrari Testarossa devenu son emblème. Chaque note de Nightcall semble imbibée de cette histoire fabriquée, invoquant les fantômes du cinéma des années 80, les couchers de soleil façon Miami Vice et les rêves en VHS saturés de parasites. On dirait une chanson sortie d’une cassette oubliée sur la plage arrière d’une DeLorean en plein soleil.
Nightcall a cette étrange quiétude, comme l’air avant l’orage ou le silence à l’intérieur d’une voiture lancée à pleine vitesse à trois heures du matin. Venue de CSS, Lovefoxxx ressemble à un signal lointain ; sa voix tranche le décor chromé avec quelque chose de fragile, presque humain. Sa présence transforme le morceau en un duo entre machine et souvenir. Le rythme n’accélère jamais. Il flotte. Les synthés brillent plus qu’ils n’explosent. Tout est calibré pour la longue route, ce moment où les lumières de la ville se fondent, et où les pensées ralentissent au rythme des lampadaires qui défilent.
À l’époque de la sortie de *Nightcall*, nous ne ressentions pas vraiment de pression, à part le fait que nous sortions un morceau avec la moitié de Daft Punk.
(Vincent Belorgey, Mixmag, 2022)
Nightcall est arrivé à un moment où la pop était devenue lisse et stérile. Il a ramené du mystère, du grain, de la texture. À partir des restes de la disco, Daft Punk avait déjà érigé des cathédrales sonores grâce à la French touch. Kavinsky, lui, suivait une voie plus sombre, éclairée seulement par des LED de tableau de bord et des lampadaires brisés. La chanson n’a pas simplement collé à l’esthétique de Drive, elle l’a créée. Le film aurait gardé son élégance, mais il lui aurait manqué l’essentiel : la fraîcheur, l’esprit, l’invitation à disparaître.
Après Nightcall, la synthwave n’était plus une niche. Elle s’est diffusée dans les mèmes, les jeux indépendants, la pub, la mode. Kavinsky a capté une ambiance dont on ne savait même plus qu’on l’attendait ; il n’a suivi aucune tendance. Ensuite, il a presque tout arrêté, comme s’il avait déjà dit ce qu’il avait à dire. Un seul morceau, quatre minutes et dix-sept secondes, a suffi pour enfermer à jamais une sensation dans un coin du cerveau. Certains titres s’éteignent. Celui-ci tourne au ralenti, discret, constant, pour toujours.