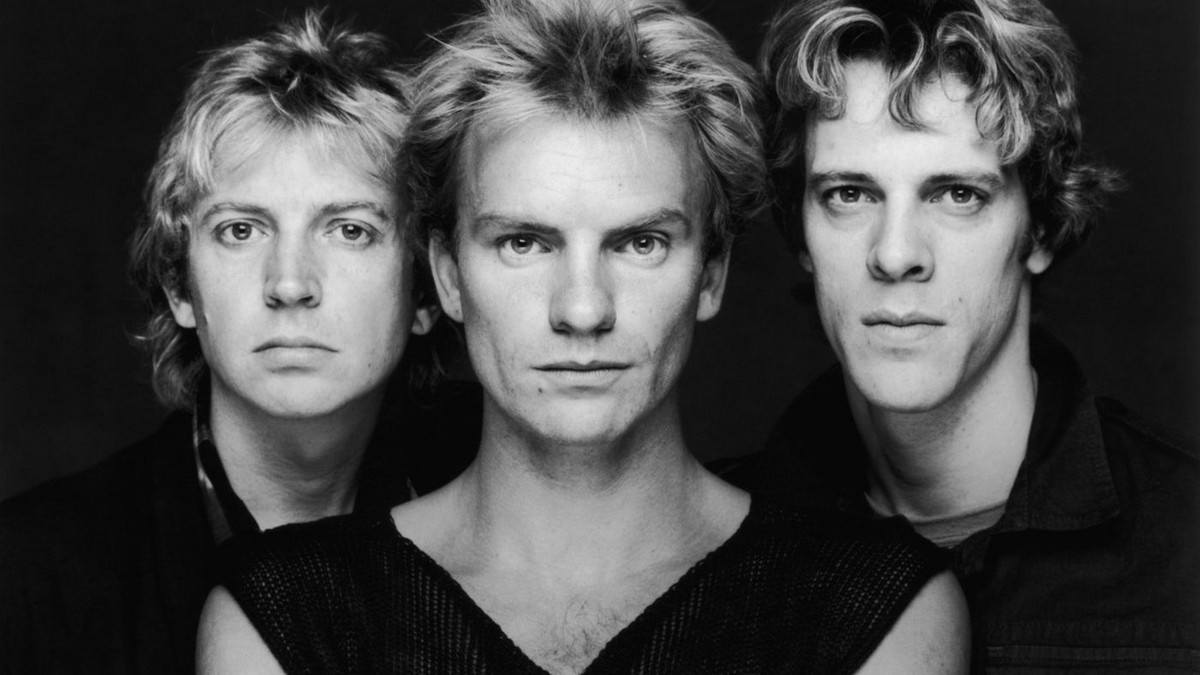Échos d’élévation
L’ouverture de Where The Streets Have No Name se déploie comme un paysage qui se révèle lentement. La guitare de The Edge s’élève par couches successives, son effet de delay créant une répétition scintillante qui devient l’échafaudage du morceau entier. Les notes tournent en boucle comme des échos dans un canyon, puis le reste du groupe entre avec une sensation d’élan. La batterie de Larry Mullen Jr. est tendue et urgente, la basse d’Adam Clayton vibre avec régularité, et la voix de Bono surgit avec à la fois du désir et de l’élévation. L’enregistrement de cette introduction a d’ailleurs mis à rude épreuve la patience du producteur Brian Eno, qui aurait tenté d’effacer la bande pour forcer un nouveau départ. Malgré les tensions, il en est sorti une architecture sonore où chaque élément s’emboîte avec précision.
Le morceau est sorti en 1987 sur The Joshua Tree, un album façonné par les contradictions et les déserts américains. U2 en a enregistré une partie dans une maison des collines de Hollywood, nourris de documentaires politiques et d’images d’idéalisme et de vide spirituel. Le groupe cherchait quelque chose de vaste, d’ouvert, et cette chanson a capturé cet élan. Sa structure s’étire comme une route désertique, avec des dynamiques qui montent et redescendent en vagues. Le son n’appartient à aucun genre précis. Il tient du post-punk, du rock de stade, avec des touches de textures ambiantes et d’inflexions gospel.
En concert, la chanson est devenue un moment de transcendance dans les shows de U2. Elle ouvrait souvent les spectacles de la tournée Joshua Tree, installant une ambiance faite de lumière, d’ombres et de sons remplissant l’espace comme un rite. Dans le clip du single, le groupe la joue sur un toit à Los Angeles, provoquant des embouteillages et une petite intervention de la police. Cette performance capturait un désir de perturbation et de lien. L’événement faisait écho au dernier concert sur le toit des Beatles, mais avec une énergie différente, plus publique, plus agitée.
*Where The Streets Have No Name* ressemble davantage au vieux U2 que n’importe quelle autre chanson de l’album, parce que c’est une esquisse. J’essayais simplement de dessiner un lieu, peut-être un lieu spirituel, peut-être un lieu romantique… quelque chose qui me parlait, alors j’ai commencé à écrire sur un endroit où les rues n’ont pas de nom.
(Bono, Propaganda magazine, 1987)
La chanson a trouvé un écho bien au-delà de sa sortie initiale. Elle s’est liée à l’état d’esprit de transformation et de quête d’identité qui marquait la fin des années 80. Elle a été jouée lors de concerts caritatifs dans l’esprit de Live Aid, et résonnait dans les manifestations, les rassemblements spirituels. Son titre, issu des réflexions de Bono sur les divisions sociales à Belfast, portait un désir d’unité et d’effacement des frontières. Avec le temps, le morceau a trouvé sa place dans la culture comme un symbole d’immensité et d’espoir, même vidé de ses significations précises.
La force durable de Where The Streets Have No Name tient à sa conception sonore et à sa portée émotionnelle. Il avance avec une clarté qui invite à la projection. Il ouvre un espace. Le jeu entre la guitare saturée de delay et le rythme en propulsion crée une sensation d’élan qui reste vivante, des décennies plus tard. L’ambition et la tension du groupe au moment de sa création restent audibles dans l’atmosphère du morceau. C’est une pièce qui semble continuer à se déplier, comme un paysage vu depuis les hauteurs, qui révèle davantage à mesure qu’on le contemple.